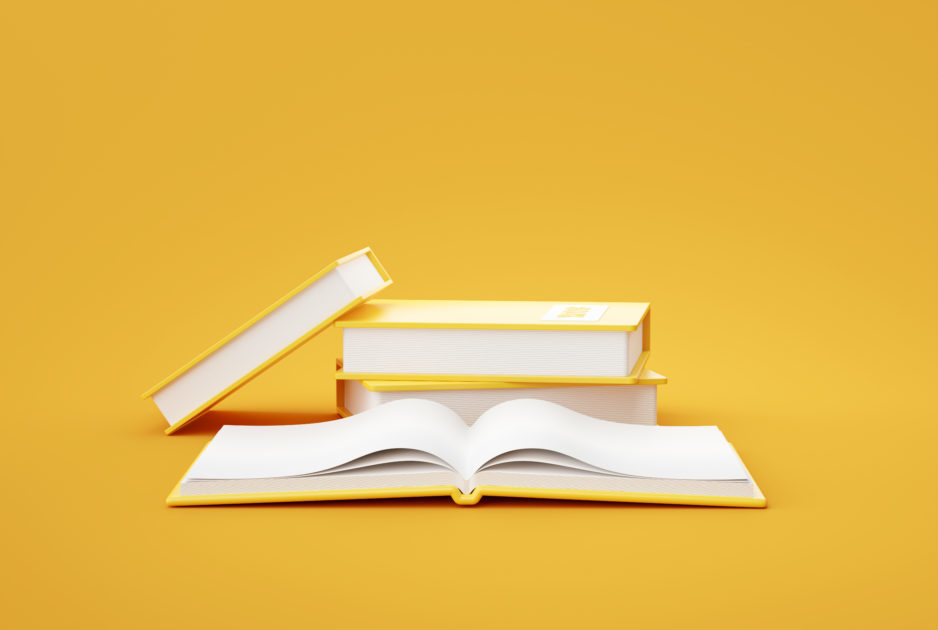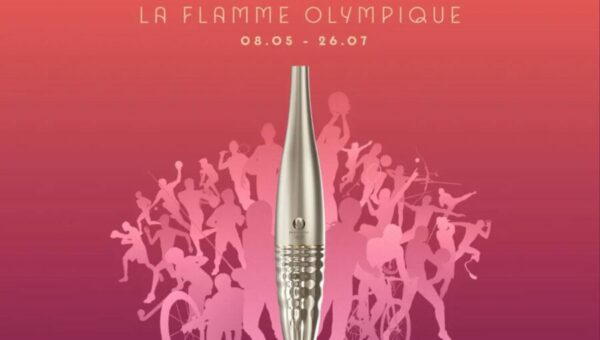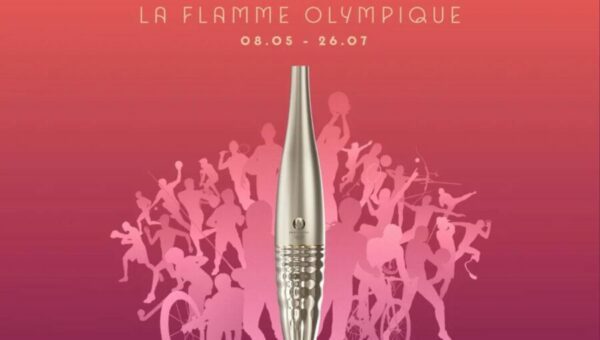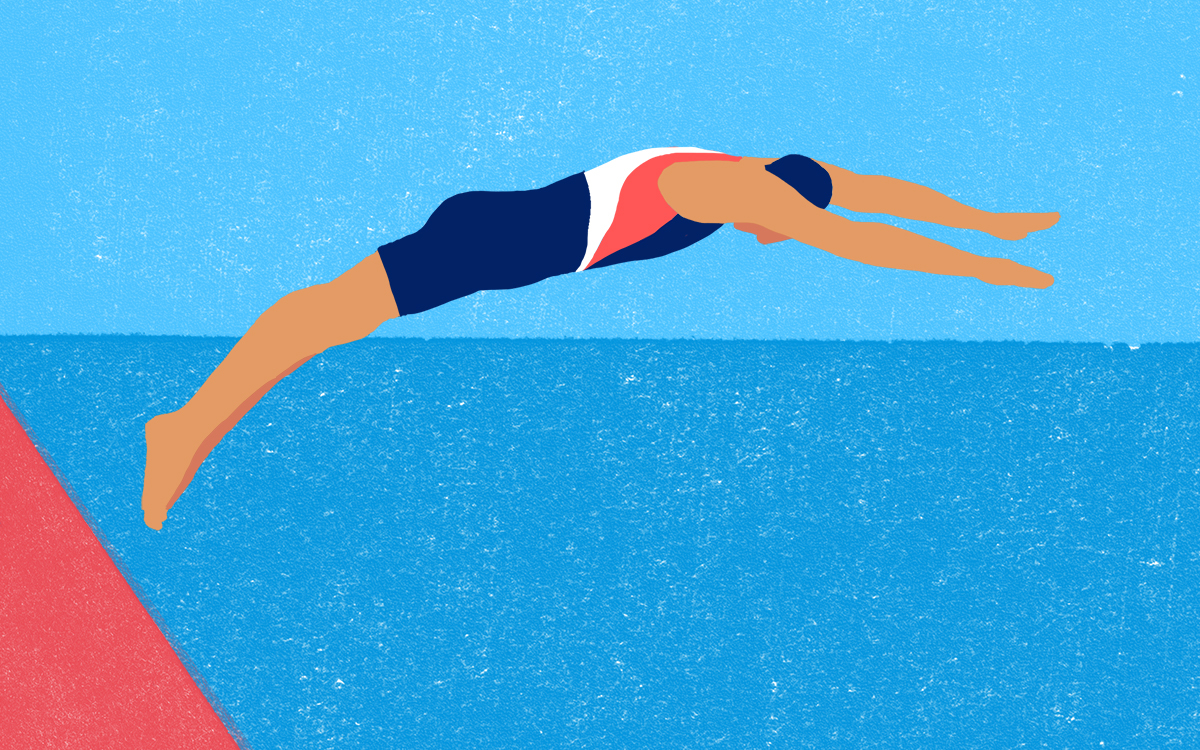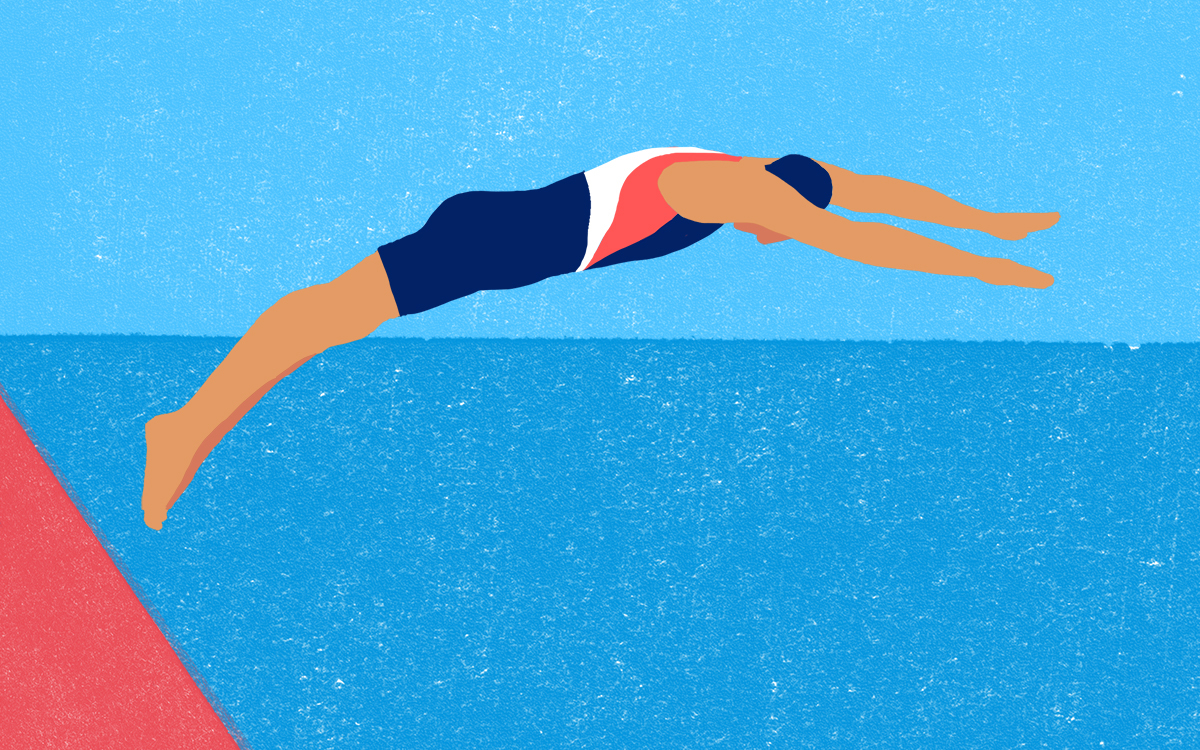Un article de Wikipédia, l’encyclopédie libre. Mamadou Thiam Fiche d’identité Nom de naissance Mamadou Thiam Surnom Dou-Dou Nationalité France Naissance (52 ans) Diofior, Sénégal Taille 1,75 m (5 ′ 9 ″) Catégorie Poids super-welters Palmarès Professionnel Combats 58 Victoires 49 Victoires par KO 46 Défaites 9 Titres professionnels Champion d’Europe poids super-welters EBU (1998-1999, 2001) Dernière mise à jour : 7 février 2014 Mamadou Thiam est un boxeur français né le à Diofior au Sénégal.
Cet article est une ébauche concernant un boxeur français. Vous pouvez partager vos connaissances en l’améliorant (comment ?) selon les recommandations des projets correspondants. Mamadou Thiam est un boxeur français né le 25 janvier 1972 à Diofior au Sénégal. Carrière[modifier le code] Il a grandi à Besançon, dans le quartier des Clairs-Soleils1,2,3,4. Passé professionnel en 1993, il devient champion de France puis d’Europe des super welters. Il dispute deux championnats du monde WBA des super welters, s’y inclinant les deux fois avant la limite. La première fois, le 22 juillet 2000 à Miami, il perd face au portoricain Felix Trinidad par KO technique à la 3e reprise. La seconde fois, le 10 août 2002 à Marseille, il laisse à nouveau le titre mondial s’échapper face au panaméen Santiago Samaniego par abandon à la 12e reprise. Palmarès[modifier le code] Mamadou Thiam fait ses débuts professionnels le 20 novembre 1993. Champion de France des super welters en 1997 et 1998 Champion d’Europe des super welters en 1998, 1999 et 2001 Notes et références[modifier le code] ↑ Interview Morrade Hakkar et Mamadou Thiam sur le site de Besançon-Migrations.fr (consulté le 27 octobre 2020). ↑ Mamadou Thiam remporte son championnat d’Europe face au Danois, Mickaël Rask sur le site du journal l’Est républicain (consulté le 27 octobre 2020). ↑ Jean Josselin entre dans l’histoire bisontine sur le site de radio Plein air (consulté le 27 octobre 2020). ↑ Thiam, de Mamadou au Boxing Punch sur le site officiel de la Mairie de Joinville-le-Pont (consulté le 27 octobre 2020). Liens externes[modifier le code] Ressource relative au sport : BoxRec v · mLauréat des gants d’or 1987 : F. Skouma 1988 : T. Nkalankete 1989 : R. Jacquot 1990 : C. Tiozzo 1991 : G. Delé 1992 : A. Wamba 1993 : L. Boudouani 1994 : F. Tiozzo 1995 : F. Tiozzo 1996 : L. Boudouani 1997 : K. Rahilou 1998 : F. Tiozzo 1999 : M. Thiam 2000 : B. Girard 2001 : J. Lorcy 2002 : J.M. Mormeck 2003 : M. Monshipour 2004 : M. Monshipour 2005 : J.M. Mormeck 2006 : F. Klose 2007 : J.M. Mormeck 2008 : B. Asloum 2009 : A. Mezaache 2010 : S. Takoucht 2011 : A.S. Mathis 2012 : C. Rebrassé 2013 : N. Mohammedi Portail de la boxe anglaise Portail de Besançon Portail de la France <img style= »border: none; position: absolute; » src= »https://login.wikimedia.org/wiki/Special:CentralAutoLogin/start?type=1×1" height= »1″ width= »1″ alt= » »> Ce document provient de « https://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=Mamadou_Thiam&oldid=214340677 ».
Lire l’article complet sur : fr.wikipedia.org
Jean-Claude Klein, né le 22 juin 1944 à Créteil et décédé le 1er mars 2014 à Gap, était un rameur français qui a marqué l’histoire de l’aviron. Sa performance notable fut lors des Jeux Olympiques d’été de 1960 à Rome, où il a concouru dans l’épreuve de quatre avec barreur, remportant la médaille d’argent. Cette distinction olympique représente le sommet de sa carrière sportive. Vous pouvez trouver plus d’informations sur sa carrière et son héritage dans le domaine de l’aviron [ici]